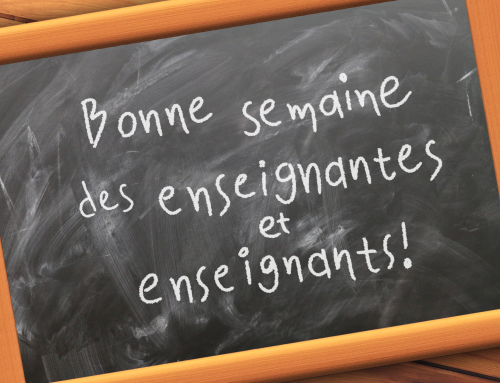Par Félix Cauchy-Charest, conseiller en communication CSQ
Par Félix Cauchy-Charest, conseiller en communication CSQ
Conférence coup-de-poing d’Émilie Nicolas au Congrès de la Fédération des professionnelles et des professionnels de l’éducation (FPPE-CSQ) : remettre du sens, sortir du brouillard.
La journaliste, chroniqueuse et animatrice n’a pas mis de gants blancs. Elle a nommé la réalité, sans filtre, sans politesse excessive. Émilie Nicolas n’a pas cherché à ménager les susceptibilités. Elle a creusé, a nommé et a mis à nu ce que tant de professionnelles et de professionnels de l’éducation vivent tous les jours : l’impression de se battre seuls contre une machine froide, déconnectée, qui préfère les colonnes de chiffres aux besoins des enfants.
Le vernis craque : sous la gestion, le mépris
Ce qui ressort d’abord, c’est une colère lucide. On entendait les murmures d’approbation, pendant que la conférencière dénonçait un État de plus en plus autoritaire, qui cache ses incompétences derrière la multiplication de règlements. Une technocratie qui impose des objectifs sans fournir les moyens, qui exige des résultats sans comprendre les enjeux, et qui réduit l’action publique à un jeu de tableaux Excel.
On impose des diagnostics, pas pour aider, mais pour prouver qu’il faut aider. On réduit les élèves à des cases à cocher. Et pendant ce temps, les professionnelles et professionnels courent. Ils se déchirent entre le devoir moral de répondre aux besoins des enfants et la machine comptable qui les traite comme des ressources jetables.
Le mot qui revient : épuisement. Pas seulement de travailler trop, mais de travailler à vide. De se faire dire qu’ils devraient en faire plus, alors qu’ils donnent déjà ce qu’ils n’ont plus.
Approche disciplinaire, gestion de la misère
Émilie Nicolas n’a pas tourné autour du pot : on criminalise les problèmes sociaux. L’itinérance, la pauvreté, les besoins criants des jeunes deviennent des menaces à neutraliser. Le système s’est construit sur la défiance : on centralise, on retire les marges de manœuvre, on infantilise les professionnelles et professionnels. Les ministères n’ont plus confiance en celles et ceux qui sont sur le terrain.
Et tout ça, pourquoi? Pour donner l’illusion qu’on contrôle encore quelque chose. Pour faire croire à la population qu’on est aux commandes, pendant que les systèmes publics s’effondrent lentement, mais sûrement.
Les miettes qu’on se lance à la figure
Le néolibéralisme, ce n’est pas une théorie. C’est une réalité concrète qui pousse les gens à se battre entre eux pour des miettes, pendant qu’on perd de vue la mission commune. « Diviser pour régner » n’a jamais été aussi rentable.
À force de manquer de tout, on se compare. On se jalouse. On se replie. On regarde l’autre comme un rival, pas comme un allié. Et pendant qu’on cherche un coupable autour de nous, la droite, elle, laboure. Elle prépare son terrain, elle peaufine ses arguments, elle infiltre le langage public avec ses obsessions de performance, de mérite, de responsabilisation individuelle.
Pendant qu’on s’épuise, ils avancent
Mais le message d’Émilie Nicolas n’était pas désespéré. Il était surtout lucide. Et appelait à un réveil. Les syndicats, a-t-elle rappelé, doivent redevenir des lieux de résistance politique. Pas seulement pour défendre les conditions de travail, mais pour porter un projet de société, pour faire de l’éducation populaire. Pour créer des espaces où on peut enfin nommer ce qui nous ronge, et décider, ensemble, d’y mettre fin.
Le nerf de la guerre, c’est l’organisation. Syndiquer. Parler. Témoigner. Et surtout, refuser de croire qu’on est seuls. Lutter contre le sentiment d’impuissance, contre l’isolement, contre l’idée fausse que personne ne nous comprend.
Ce n’est pas en répondant aux exigences d’un système malade qu’on va le guérir. C’est en le dénonçant. En le contournant. En le transformant.
Creux de vague… ou début de renaissance?
On l’a senti dans la salle : on est dans un creux. Une période de fatigue, de retrait, mais les graines sont là. Éparpillées dans les écoles, dans les milieux, dans les conversations au travail, dans les événements informels, autour d’un café.
L’ambiance est peut-être lourde, mais le terreau est fertile. Et si on se fie aux commentaires des déléguées et des délégués dans la salle, il y a un appétit : celui de ne plus accepter l’inacceptable. Celui de sortir du brouillard. Celui de retrouver la rage de penser autrement.
Texte aussi paru dans CSQ Magazine
 While we work ourselves into exhaustion, the right reaps the benefits: Lecture by Émilie Nicolas at the FPPE Congress
While we work ourselves into exhaustion, the right reaps the benefits: Lecture by Émilie Nicolas at the FPPE Congress
By Félix Cauchy-Charest, CSQ Communications Advisor
Émilie Nicolas gave a hard-hitting talk at the Fédération des professionnelles et des professionnels de l’éducation (FPPE-CSQ) Congress: Making sense, emerging from the fog.
The journalist, columnist and host didn’t pull any punches. She gave an unfiltered look at reality, without excessive politeness. Émilie Nicolas didn’t try to spare any sensitivities. She dug deep, identified and laid bare what so many education professionals experience every day: the feeling of fighting alone against a cold, disconnected machine that prefers bottom lines over children’s needs.
The varnish is cracking: The contempt beneath the surface
What stands out first is clear anger. Murmurs of approval could be heard as the speaker denounced an increasingly authoritarian state that hides its incompetence behind a proliferation of regulations. A technocracy that imposes objectives without providing the means, that demands results without understanding what’s at stake and that reduces public action to a set of Excel spreadsheets.
Diagnostics are imposed, not to help, but to prove that help is needed. Students are reduced to check boxes. And all the while, education professionals are racing around. They are torn between the moral duty to meet children’s needs and the accounting machine that treats them as disposable resources.
The word that keeps coming up: exhaustion. Not just from working too much, but from working on empty. From being told they should do more, when they’re already giving more than they have to give.
Disciplinary approach, managing misery
Émilie Nicolas didn’t beat around the bush: We criminalize social problems. Homelessness, poverty and the blatant needs of young people become threats to be neutralized. The system has been built on a foundation of mistrust: centralization, loss of autonomy, infantilization of professionals. Ministries no longer have confidence in the people who work in the field.
What is the reason behind all this? To give the illusion that we are still in control of something. To make people think we’re in charge, while public systems slowly but surely collapse.
Crumbs thrown in each other’s faces
Neoliberalism is not a theory. It’s a concrete reality that drives people to fight each other for crumbs, while losing sight of the common goal. “Divide and conquer” has never been so profitable.
When you lack everything, you compare yourself to others. We become jealous of one another, retreat and consider others rivals instead of allies. And while we’re looking for someone to blame, the right is ploughing ahead. It’s making plans, refining its arguments and infiltrating public language with its obsessions with performance, merit and individual accountability.
While we work ourselves into exhaustion, they forge ahead
But Émilie Nicolas’s message was not desperate. Above all, it was clear. And called for an awakening. The unions, she reminded us, must once again become places of political resistance. Not just to defend working conditions, but to promote a vision for society and popular education. To create spaces where we can finally name what’s eating away at us, and decide, together, to put an end to it.
The key to success is organization. Unionizing. Talking. Speaking out. And above all, refusing to believe that we’re alone. Fighting feelings of powerlessness, isolation and the misconception that no one understands us.
Responding to the demands of a sick system will not cure it. This can only be achieved by denouncing it. By going around it. By transforming it.
Stagnation… or the beginning of a renaissance?
You could feel it in the room: We are in a slump. A period of fatigue, of withdrawal, but the seeds are there. Sown in schools, in communities, in conversations at work, at informal events, over coffee.
The atmosphere may be heavy, but the soil is fertile. And if the comments of the delegates in the room are anything to go by, there’s an appetite for no longer accepting the unacceptable. Emerging from the fog. Rediscovering the rage to think differently.
Text also appeared in CSQ Magazine